« Dans mon pays, c’est la première fois qu’on va faire écarter par la justice des candidats à la présidentielle »
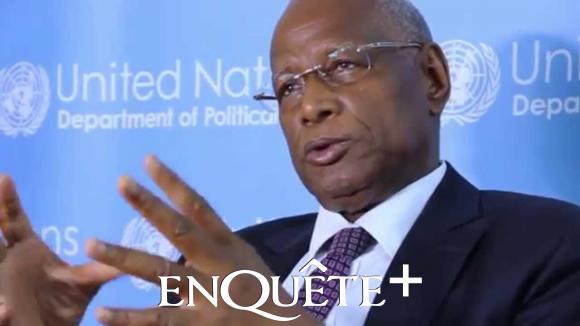
Sans fard ni concession, l’historien et ancien ministre sénégalais jette un regard lucide sur les sujets les plus brûlants de l’actualité continentale. C’est un Abdoulaye Bathily amer et inquiet qui se confie à Jeune Afrique. L’ancien dirigeant marxiste reste un homme engagé. Diplômé des universités de Dakar et de Birmingham, en Grande-Bretagne, ce grand historien échappe depuis longtemps au pré carré franco-africain. Envoyé spécial de l’ONU et de l’Union africaine dans de multiples pays en crise, il possède une expertise unique, qui lui fait prédire la disparition prochaine de la Cour pénale internationale. Rien de moins. De son échec à la présidence de la Commission de l’UA, en janvier 2017, l’homme de 71 ans a retiré un surcroît de lucidité.
Après l’acquittement de Jean-Pierre Bemba et les points marqués en 2018 par la défense de
Laurent Gbagbo, la CPI est-elle encore crédible ?
Il ne s’agit pas de remettre en question la nécessité de poursuivre les auteurs de crimes
de masse, mais c’est un fait que la CPI est aujourd’hui perçue, et non sans raison, comme un tribunal mis en
place pour juger uniquement les crimes commis sur le continent africain. Elle ne se préoccupe pas plus des
Rohingyas que des Palestiniens, mais quasi exclusivement des Africains. Donc oui, la Cour a perdu de sa
crédibilité. Et, à mon avis, elle n’a plus beaucoup de temps à vivre, ne serait-ce que parce que, compte tenu
de l’évolution du monde, les enquêtes sur les droits de l’homme seront de plus en plus difficiles à mener.
Comment expliquez-vous le fait que la CPI ne s’intéresse qu’aux crimes commis en Afrique ?
En dehors de l’Afrique, il y a des grands pays qui sont concernés et qui, de toute évidence, ne veulent pas
que ces cas soient considérés par la CPI.
Voulez-vous dire qu’Israël est protégé par les États-Unis ?
Absolument.
Et la Birmanie par la Chine ?
Par la Chine et par d’autres dans la région.
Quel rôle ont joué les procès Bemba et Gbagbo dans cette évolution de la CPI ?
Je vous l’ai dit : ces procès ont entamé la crédibilité de la CPI, et ce n’est pas le fait d’arrêter un chef
anti-Balaka de Centrafrique [Patrice-Édouard Ngaïssona, interpellé en France le 12 décembre] qui va sauver
son honneur. Bien sûr qu’il faut que tous les crimes contre l’humanité soient punis et que personne ne puisse
échapper à la justice internationale. Mais nous ne devons pas nous accommoder d’une justice à deux
vitesses. Les Africains doivent prendre leurs responsabilités. C’est difficile, mais pas impossible. Regardons
ce qui a été fait en Sierra Leone ou au Rwanda. Surtout, l’Union africaine doit se pencher sur cette question.
Citeriez-vous le procès de Hissène Habré par les Chambres africaines extraordinaires, à Dakar, parmi les
exemples à suivre ?
Oui, même si ce procès a été conduit dans une période où le processus démocratique était en progrès sur le
continent. Or, il me semble qu’aujourd’hui nous traversons une phase de recul démocratique. Et pas
uniquement sur le continent ! On voit se développer dans le monde des régimes populistes, ainsi qu’un
racisme et un autoritarisme décomplexés.
La Guinée équatoriale doit-elle livrer à la justice l’ex-président gambien, Yahya Jammeh, qui a trouvé refuge
sur son territoire ?
Une commission vérité et réconciliation a été mise en place à Banjul. Je ne sais pas ce qu’elle va proposer,
mais si ses crimes sont avérés et si les Gambiens demandent son extradition, Yahya Jammeh devra rendre
des comptes. On ne peut quand même pas faire comme si de rien n’était !
Pensez-vous, comme les partisans de Laurent Gbagbo, que la CPI pratique une justice de vainqueurs ?
De fait, jusqu’ici, c’est dans le camp de Gbagbo qu’il y a eu des arrestations. Et à la lumière des différentes
audiences de La Haye, il me semble que le dossier comporte de nombreuses faiblesses, qui laissent penser
que les juges n’auront pas d’autre choix que de libérer Gbagbo.
De le libérer et de l’acquitter ?
Je ne sais pas ce qui sera décidé, mais les éléments de preuve sur lesquels s’est appuyée l’accusation n’ont
pas été probants. De toute façon, la Côte d’Ivoire ne pourra pas se passer d’une réelle politique de
réconciliation nationale. Si Simone Gbagbo est aujourd’hui libre, je ne vois pas pourquoi Laurent Gbagbo ne
le serait pas demain. J’ajoute que si cela peut conduire à l’apaisement en Côte d’Ivoire, je suis pour.
Autre pays, autre situation : pensez-vous, comme certains, qu’en faisant le procès des putschistes de
septembre 2015, le régime du président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré remue le couteau dans la
plaie et retarde la réconciliation nationale ?
Je ne veux pas me prononcer sur une affaire qui est devant la justice. Simplement, il se trouve que le chef du
RSP (Régiment de sécurité présidentielle), le général Diendéré, a été mon cadet au prytanée militaire de
Saint-Louis, au Sénégal. Je le connais très bien. Au moment du putsch, j’étais à Libreville, en tant que
représentant spécial de l’ONU pour l’Afrique centrale. Avec l’accord de mon collègue et ami Mohamed Ibn
Chambas, qui était le représentant spécial de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest, j’ai appelé Diendéré tous les
jours pendant les trois jours qu’a duré le putsch. J’ai tout fait pour le dissuader. On a longuement parlé au
téléphone, je lui ai dit que c’était une aventure sans lendemain et qu’il fallait y renoncer. Naturellement, il ne
m’a pas écouté, comme Blaise Compaoré un an plus tôt, quand il avait voulu changer la Constitution. Mais je
considérais qu’il était de mon devoir de le lui dire, car je savais que le RSP était isolé, que l’armée ne pouvait
pas le suivre, et la population encore moins. Le RSP était craint mais pas aimé.
Ces dernières années, l’insécurité a gagné du terrain au Burkina. Les nostalgiques de Blaise Compaoré
ont-ils raison de dire que c’était mieux avant, car il y avait une unité nationale et une armée disciplinée ?
Ce RSP dont tout le monde parle n’était pas un modèle d’institution sécuritaire. Il ne faut pas oublier qu’en
avril 2011 il s’est mutiné contre Blaise Compaoré. À l’époque, ses hommes ont pillé des commerces dans la
capitale et réussi à faire sortir le président de Kosyam. Celui-ci a dû négocier avec les mutins pour pouvoir
retourner au palais ! Donc non, ce régiment n’était pas un modèle durable pour préserver la sécurité dans le
pays. N’oublions pas non plus que, du temps de Blaise Compaoré, le Burkina Faso était un havre de paix
pour certains groupes armés. Le MNLA y avait son quartier général ! Pas étonnant qu’aujourd’hui des
djihadistes veuillent se venger du système qui les a privés de protection.
Au Sénégal, la présidentielle aura lieu en février 2019, mais la justice a mis hors-jeu deux figures de
l’opposition, l’ex-ministre Karim Wade et l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Qu’en pensez-vous ?
Comme je vous l’ai dit, il me semble que l’on est en période de sécheresse démocratique. Au Sénégal
comme ailleurs se pose la question du rôle de la justice dans les procès d’opposants, et cela fragilise le
système démocratique.
Iriez-vous jusqu’à dire que la justice sénégalaise est instrumentalisée ?
Cela fait dix-huit mois que je dis que le procès Khalifa Sall est politique. La Cour de justice de la Cedeao a
rendu un jugement qui considère que la procédure n’a pas été équitable. L’État sénégalais, qui est membre
de la Cedeao et a adhéré à la Charte de la Cedeao, doit se soumettre à ce jugement, mais il ne l’a pas fait
jusqu’ici. La Commission des droits de l’homme de l’ONU a abouti pratiquement à la même conclusion. Tout
cela montre bien qu’il y a volonté d’éliminer un adversaire. On ne règle pas des problèmes politiques en se
servant de la justice. Actuellement, lorsque les gens soupçonnés de malversations sont contre vous, ils
tombent sous le coup de la loi. Mais lorsqu’ils sont avec vous, vous les épargnez. À partir de ce moment-là,
la justice perd sa crédibilité, et le jugement sa légitimité aux yeux de l’opinion. C’est cela qui amène les
tensions, et demain une ambiance de règlements de comptes qui porte en germe le recul de la démocratie.
Vous diriez la même chose pour Karim Wade ?
Les cas de Karim Wade et de Khalifa Sall sont différents, mais tous deux doivent faire l’objet d’un traitement
équitable. Or d’autres personnes ont été poursuivies par le même tribunal, la Crei [Cour de répression de
l’enrichissement illicite], mais leurs dossiers à eux ont été gelés. Je vais vous dire une chose : voilà cinquante
ans que je participe au combat politique au Sénégal, et c’est la première fois que l’on fait écarter par la justice
des candidats à la présidentielle.
Au Togo, l’opposition vient de boycotter les législatives du 20 décembre. Comment sortir de l’impasse ?
Malheureusement, la Cedeao ne parvient pas à aider à résoudre cette crise. Il y a quelques années, elle
avait proposé à ses membres de limiter à deux le nombre de mandats présidentiels. À l’époque, le Togo et la
Gambie de Jammeh s’y étaient opposés. Aujourd’hui, il ne reste plus que le Togo et, au fond, la question est
de savoir si, pour la prochaine présidentielle, le président doit encore être candidat. Personnellement, je
souhaite que Faure Gnassingbé fasse ce sacrifice pour son pays et qu’il renonce à se présenter en 2020. Ce
serait un signal fort, qui le grandirait davantage et créerait les conditions d’une réconciliation dont il serait le
garant historique. Après trois mandats, il a suffisamment servi le pays et bien montré ses capacités. On peut
servir son pays de bien des manières. Beaucoup d’anciens chefs d’État participent par exemple à la
résolution de conflits sur le continent. À mon avis, ils jouent un rôle plus important qu’à l’époque où ils étaient
au pouvoir. Le président togolais est encore jeune. Il pourrait tenir ce rôle-là. Sur le continent, on peut faire
l’économie de tout ce sang et de toutes ces larmes.
En Guinée, l’opposition soupçonne le président Alpha Condé de vouloir modifier la Constitution pour pouvoir briguer un troisième mandat en 2020. Cela vous préoccupe-t-il ?
Je dis que la démocratie doit se construire par des consensus. Je sais par expérience qu’à chaque fois qu’il
n’y a pas de consensus et qu’on s’engage dans la voie conflictuelle, cela augure de situations très difficiles
à maîtriser.
Avez-vous été surpris par la décision de Joseph Kabila de ne pas modifier les règles du jeu en RD Congo
pour briguer un troisième mandat ?
C’est une décision qu’il faut saluer et mettre au crédit du peuple congolais, dans toutes ses composantes : les
Églises, la population, les partis politiques, la société civile… Ils se sont mobilisés et Joseph Kabila les a
écoutés, c’est positif. J’aurais souhaité que le président Faure prenne la même décision. Je m’interroge
néanmoins sur l’avenir du processus et sur la capacité de l’État congolais à tenir des élections transparentes.
Et croyez-vous à la promesse du président burundais de ne pas se représenter en 2020 ?
Si l’on veut construire des systèmes démocratiques durables, le respect de la parole donnée est
fondamental. Au Burundi, le premier engagement qu’avait pris Pierre Nkurunziza était de ne pas briguer un
troisième mandat, mais il l’a fait malgré tout en 2015. Il annonce maintenant qu’il ne va pas être candidat à la
prochaine élection ? J’attends de voir. J’ajoute que le Burundi émet des signaux inquiétants. Quand je vois
que l’ancien président Pierre Buyoya, qui a participé à la mise en place des accords d’Arusha et travaille
aujourd’hui pour le règlement des conflits au Mali et ailleurs, est visé par un mandat d’arrêt, je me dis qu’il y a
de quoi être préoccupé pour l’avenir du Burundi.
Au Cameroun, la réélection de Paul Biya avec plus de 71 % des voix, vous y croyez ?
Par-delà les chiffres qui sont affichés, les élections ont montré une chose : c’est la volonté de changement du
peuple camerounais. Et quand on voit ce qui se passe dans la partie anglophone du pays, c’est
indispensable, car il faut négocier.
À Madagascar, pays pour lequel vous avez également été le représentant d’António Guterres, une nouvelle
loi impose au président sortant de démissionner de son poste soixante jours avant la date du scrutin s’il veut se représenter. C’est ce qu’a fait Hery Rajaonarimampianina, le 7 septembre dernier. Est-ce une bonne loi ?
C’est une excellente loi ! Très souvent, quand les présidents en exercice briguent un nouveau mandat, ils ont
un avantage sur leurs concurrents : sous prétexte qu’ils sont toujours au pouvoir, ils utilisent les moyens de
l’État – l’administration, les véhicules, etc. – pour faire campagne. Je crois que cette innovation de
Madagascar est très importante et mérite d’être considérée. En la matière, le Cap-Vert avait ouvert la voie :
là-bas, quand le président est candidat pour un deuxième mandat, il ne peut plus parler au nom de l’État.
Quand l’élection a lieu au mois de janvier ou février suivant, il ne peut même pas prononcer son discours de
fin d’année. C’est le président de l’Assemblée nationale qui délivre le discours à la nation. Et ensuite, il n’a
plus le droit d’utiliser les moyens de l’État et ne dispose plus que d’une petite escorte de sécurité. Je dirais
donc que le Cap-Vert a montré l’exemple et que Madagascar est allé encore plus loin. Peut-être cela
explique-t-il, dans une certaine mesure, que le président sortant n’ait pas pu se qualifier pour le deuxième
tour, le 19 décembre… Dans tous les cas, c’est un indicateur important de démocratie, qui met les différents
candidats sur un pied d’égalité.
Avez-vous été surpris par ce soutien ?
Surpris, c’est trop dire. En tout cas, j’étais partisan d’une pacification des relations entre Paris et Kigali. Par
ailleurs, je connais personnellement Mme Mushikiwabo. J’ai travaillé avec elle quand elle était ministre des
Affaires étrangères et quand j’étais en Afrique centrale. Je pense qu’elle pourra continuer de relever les défis
qui se posent à la Francophonie.
Emmanuel Macron est-il trop interventionniste en Afrique ?
Pour le moment, je vois surtout de la continuité et, en ce qui concerne le Sahel par exemple, une poursuite
de l’engagement décidé par François Hollande. Je ne vois en revanche ni interventionnisme ni changement
qualitatif. De toute façon, il faut banaliser les relations entre l’Afrique et la France et les placer au même
niveau que les relations entre l’Afrique et la Grande-Bretagne ou avec les États-Unis.
En Afrique, les prêts de la Chine sont passés de 5 à 60 milliards de dollars entre 2006 et 2018. Va-t-on vers
un nouveau surendettement du continent ?
Une chose est sûre : l’entrée en scène de la Chine a permis à beaucoup de pays d’accélérer leur programme
de développement. Maintenant, la question est de savoir si les États qui empruntent à la Chine se sont dotés
de suffisamment de capacités de négociation pour que cette dette soit contractée à bon escient, c’est-à-dire
sur des projets réellement viables, et pour que ces projets puissent induire un développement transformateur
de l’économie africaine. Et là, c’est moins évident. Certes, des infrastructures ont été construites, mais cela
ne suffit pas : il faut parvenir à un partenariat gagnant-gagnant dans la transformation des matières premières
et dans l’industrialisation du continent. Cela favorisera l’émergence d’une classe moyenne d’entrepreneurs
africains, d’une bourgeoisie conquérante, qui pourra être la partenaire des entreprises chinoises et autres.
Sinon, ce sera la poursuite de la dynamique de Berlin, c’est-à-dire le partage de l’Afrique, comme en 1885.
Avez-vous remarqué que la plupart de nos partenaires parlent de ruée vers l’Afrique, comme au XIXe siècle ?
Très souvent, les Africains participent à des sommets internationaux sans être préparés à parler d’une seule
voix et à développer une stratégie commune. Donc, si la dette africaine doit servir à quelque chose, c’est à
un rôle de transformation. Si tout cela se résume à un troc de matières premières contre des infrastructures,
cela va poser un problème à terme, et le syndrome de l’endettement risque de reprendre.






















