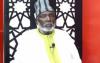Un accueil malade

L’accueil dans les hôpitaux est souvent la première épreuve pour les patients et leurs proches. Entre manque d’informations, lenteur des formalités et personnel peu disponible, beaucoup peinent à se retrouver dans ces lieux censés être des refuges. Pourtant, un bon accueil peut apaiser les craintes et améliorer l’expérience du soin.
L’on entend souvent que les hôpitaux sénégalais sont plus malades que leurs patients, un sentiment presque unanimement partagé par de nombreux usagers. En plus d’être sous perfusion à cause de ses défaillances techniques et d’un plateau médical au stade d’incurabilité avancée, son service d'accueil présente des anomalies chroniques qui font geindre les usagers.
Selon certains spécialistes comme les professeurs A. Bouida Wahid et Nouira Semir, l’accueil est le premier maillon de la chaîne de soins. Il donne le ton, la première impression et peut faciliter ou compliquer la suite de la relation entre le patient et l’établissement. Tout se joue dans les premières secondes, soutiennent-ils.
A l’entrée principale du centre hospitalier universitaire de Fann, les vigiles accueillent bien patients et visiteurs sans grand obstacle. Mais à quelques mètres du portail, circulent des personnes, dont une, ordonnance à la main, demandant de l’aide aux passants pour pouvoir l’acheter. À gauche, à l’entrée de cet établissement hospitalier communément appelé ‘’Hôpital Fann’’, se trouve le bâtiment administratif, mais également le service d’urgence. Babacar Wade, un sportif de forte corpulence âgé de 37 ans, est venu faire ses analyses. Pour lui, l’accueil est important. C'est une question cruciale qui mérite d’être posée, car selon lui qui vit en Europe, il y a une différence énorme entre les hôpitaux du Nord et ceux du Sud.
D’après lui, c'est une problématique qui relève de l’humanisme. “On ne vient pas à l’hôpital par simple plaisir. Je n’ai jamais rencontré de gros problèmes au niveau de l’accueil, ici au Sénégal. Il est vrai, tout de même, que j’y viens très rarement, parce que je vis en Europe’’, explique-t-il.
À côté de M. Wade se trouvaient trois femmes assises et qui arrivaient à entendre quelques bribes de ce qu’il disait. Interpellées, elles ont préféré s’emmurer dans un silence, par peur que leur identité soit dévoilée. Rassurées, elles ont fini par accepter de donner leur avis. Fatim Sène a la quarantaine, habillée tout en noir et d’un voile rose mal ajusté, peut-être à cause de la fatigue qui pouvait se lire sur son visage. Cette habitante de Lambaye déplore le traitement qui lui a été réservé par les agents de l'hôpital, elle qui, depuis 5 h, n’a pu fermer les yeux, dit-elle. “Je suis là depuis 5 h pour voir un parent malade, mais sachez que c’est le calvaire. En plus de leur interminable formalité, le plus difficile, c’est le manque d’informations. Nous ne savons pas à qui nous adresser, tellement nous manquons d’interlocuteurs. Ce sont ceux qui sont censés vous aider qui vous fuient”, fulmine-t-elle avec amertume.
Au centre hospitalier national d'enfants Albert Royer y règne un calme presque de cimetière. Assise sous le soleil, certainement pour se réchauffer, Anna Da Costa est à rebours des premiers intervenants. D’une équanimité d’ailleurs très touchante avec sa voix douce et respectueuse, la dame de 48 ans soutient se sentir satisfaite de l’accueil qui lui est réservé. “D’ailleurs, tous les patients du pavillon M disent la même chose. Cela peut être aussi dû, continue-t-elle, au fait qu’il n’y a que des enfants dans ce centre. Je suis là depuis le 30 décembre, mais je ne me plains pas de la qualité de l’accueil. Ici, même les étrangers ont un bon comportement”.
Au service de neurologie du même hôpital, des hommes en blouse blanche sortaient un malade d’une ambulance. Dans la cour du jardin se trouvent des femmes couchées sur des matelas, discutant des frais très élevés de leur hospitalisation. Moussa Diaw, habillé en treillis avec ses dreadlocks, 35 ans, n'a pas en effet beaucoup de reproches à faire concernant l’accueil des hôpitaux. Sa seule préoccupation reste tout de même le coût des soins. À côté de lui, un sexagénaire habitant à Thiaroye a voulu aussi témoigner sous l’anonymat. De caractère un peu véhément, ce vieux Lébou n’a pas hésité à rembarrer tout le monde, aussi bien les médecins que le personnel administratif. “Cela fera bientôt vingt-et-un jours que j’ai emmené mon petit-fils dans cet hôpital. Le plus dur est qu’ils ne fournissent jamais d’explications claires et je crois qu’en grande partie, il y a beaucoup de jeunes et ils sont inexpérimentés, de mon point de vue. Il faut qu’on les forme davantage, qu’ils soient à l’écoute et aient de l’empathie. D’ailleurs, c’est ma femme que je laisse leur parler, sinon je risque de péter les plombs”, dit-il en ricanant et mordillant ses lèvres.
Un autre quartier, un autre établissement médical. Le centre de santé Mame Abdou Aziz des Parcelles-Assainies. L’espace est bondé de monde. Le vigile se terre seul dans son kiosque et oriente nonchalamment du doigt les usagers qui viennent s’informer. Nous parvenons à nous rapprocher de Mbène Dieng assise dans le hall du centre avec d’autres femmes en train de papoter. Âgée de 38 ans et mère de cinq enfants, elle est venue pour les soins de son dernier enfant, Mohamed, âgé à peine de 5 mois. En réponse à notre question, Mbène Dieng et le personnel hospitalier parlent rarement le même langage. “Je ne suis pas comme les autres qui se font engueuler sans rien faire. On me taxe souvent d’irascible, mais loin de là, je ne peux pas me taire face à l’injustice”.
Jetant son regard parfois de l’autre côté pour ne pas rater son tour, elle ajoute effectivement qu’il y en a certains qui sont différents. “Je me souviens, lorsque j’accouchais mon troisième enfant, j’étais tombée sur une bonne dame. Des semaines plus tard, j’avais même préparé des cadeaux pour elle en guise de remerciements. Et pour vous dire, beaucoup ont dû arrêter de se soigner dans cette structure, quand ils ont entendu qu’elle n’y officiait plus”.
Assise sur un banc en bois et manipulant son téléphone portable, Gnagna Lo est une habitante de Touba âgée de 27 ans, vivant désormais à Dakar avec son mari. Comme une vieille chanson qui l'extirpe d’une réminiscence, Gnagna a tenu à raconter cette anecdote qui lui “tient à cœur”. On voyait venir toute sa frustration. “Un soir, mon cousin qui se trouvait au boulot m’avait demandé d’accompagner sa sœur à l’hôpital. Quand on est arrivée sur les lieux, la dame chargée de la vente des tickets a refusé de prendre mes 10 000 F. J’étais alors obligée de faire le tour du quartier pour chercher de la monnaie, mais en vain. Notre sœur se tordait de douleurs et c’est finalement un homme qui avait pitié de moi qui m’a donné 500 F pour que j’achète mon ticket. Imagine cela, 500 F contre la vie d’une personne ! Ne pouvait-elle pas prendre les 10 000 F d’abord et s’occuper d’elle ? Qu’allait-elle dire si elle avait perdu la vie ?”.
Interrogées, deux sages-femmes trouvées dans deux hôpitaux différents ont accepté de se prêter à notre jeu, sous le couvert de l'anonymat. La première sera appelée A. G., une sage-femme de 27 ans qui est pratiquement à ses débuts. Elle pense que certains usagers s’induisent eux-mêmes en erreur. “Lorsqu’ils viennent dans une structure sanitaire, ils croient qu’est médecin toute personne portant une blouse. En outre, ce sont eux qui ont l’habitude de s’adresser aux mauvaises personnes ; le médecin a d’autres préoccupations. Parfois, il est submergé avec des urgences à prendre. Ceci peut expliquer leurs précipitations et le fait d’éconduire, même si je suis d’avis qu’il est nécessaire d’accorder du temps aux usagers pour les orienter. Cependant, il est bon de savoir qu’il y a des personnes qui sont recrutées dans les structures sanitaires uniquement pour l’orientation. Et s’agissant des brebis galeuses, il y en a dans toutes les professions”.
Pour Mme Diallo, l’accueil est le premier soin dont a besoin le patient. Il peut se manifester de différentes manières, mais le plus important reste, en effet, le climat de confiance que l’agent doit installer entre lui et le malade. Poursuivant son argumentaire, elle pense que l’agent doit éviter de mélanger vie de famille et vie professionnelle, laissant ses soucis à la maison.
Selon toujours la sage-femme, au Sénégal, on confond souvent l’accueil et la prise en charge. ‘’Ce que je veux dire, c’est qu’on peut vous accueillir et ne pas vous prendre en charge, peut-être pour différentes raisons’’. Sous un sourire semi-méprisant, elle estime aussi que certains patients sont très “’capricieux et veulent voir des problèmes là où il n’y en a pas’’.
Bien que la majeure partie du souci des soignants porte sur l’aspect médical, il n’en demeure pas moins que l’accueil occupe une place centrale dans le processus de guérison. Savoir accueillir est une discipline, dit le professeur A. Bouida Wahid dans son guide ‘’L’accueil du Patient’’. Ça répond à une demande, information, orientation et assurance. La personne en charge doit impérativement se doter de certaines qualités personnelles comme l’écoute, la patience, la maîtrise de soi, le respect de l’autre. Mais aussi de qualités humaines telles que la politesse, la ponctualité, l’amabilité, la tenue et une attitude correcte. L’accueil des malades n’est pas que politesse ou gentillesse, mais en grande partie, écouter et organiser l’attente, le confort de ceux qui patientent et la discrétion des consultations.