Réponse à Babacar Touré
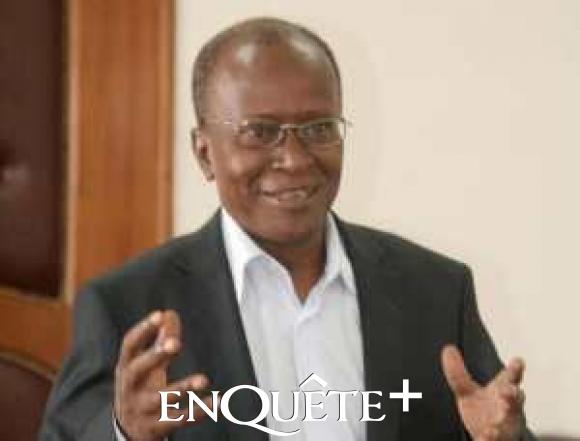
Babacar, ton interpellation – même sommative – m’a touché. D’autant plus que comme l’autre, je suis une pauvre chose qui tremble et qui ne sait pas. Aussi, je vais hasarder le ruissellement de ma propre énonciation, (nécessairement claudicante), à partir du promontoire que tu m’offres. Sans prétention. "Pourquoi moi ?" me suis-je demandé jusqu’à ce qu’un compatriote de Bordeaux – Thierno Ibrahima Dia – mette des mots sur ce que je pressentais confusément : ce moi est « un "nous tous" humble et toujours réflexif au sens de Bourdieu, c'est-à-dire ne se départant jamais au fur et à mesure qu'il avance dans sa réflexion de l'effort de revenir constamment en arrière pour mesurer la position et l'état d'où il est parti».
Et cette énonciation sera une réitération d’une parole déjà ancienne, mais non entendue, occultée par les spécialistes des rhétoriques flamboyantes. Elle essaiera de n’être ni inane ni stérile – je l’ose espérer – mais de lier chaque mot pour éviter qu’il s’enfonce dans les intervalles qui séparent, en apparence, les idées.
Le Verbe sauve l’individualité du mot par la signification globale de la phrase ; en le disant, je ne fais que réitérer Maître Eckhart.
M’efforcer donc et dans l’inconfort - puisque je ne m’exclus pas de ce que je m’en vais dénoncer - à l’exercice périlleux d’une pensée phénoménologique par la répudiation du verbalisme.
J’invite toutes les personnes de qualité que tu as citées - Kader Boye, Sémou, Mamoussé, Pathé Diagne, Amadou Aly Dieng, Marie Angélique, Fatou Sow, Ousseynou Kane, Penda Mbow, Le Pr Djibril Samb, le doyen Sembène, Boris Diop, Mame Less Camara, Moussa Paye, Malick Ndiaye, le patriarche Mamadou Dia, nous tous en somme - à s’engouffrer dans mes lacunes probables, à aller au-delà de la simple réduction phénoménologique à laquelle je me cantonne provisoirement, et à apporter leur précieux éclairage : car il s’agit de comprendre notre propre opacité, son impensé, si tant est que nous avons encore pour notre pays quelque tendresse élective.
Ma démarche, tu t’en doutes, en écho à la tienne, sera phénoménologique, son registre lyrique et sa tonalité indignée. Phénoménologique, mais aussi hardiment prescriptive, en attendant l’éclairage des hommes de sciences : sociologues, anthropologues, historiens, philosophes, etc., si tant est que les éléments de diagnostic que j’essaie de poser maladroitement sont avérés. N’est-ce pas, LE Véridique bien guidé ?
Mais trêve de précautions oratoires.
Que se passe-t-il avec El Hadj Ousseynou Diouf ? Weuz (sobriquet d’Ousseynou) a-t-il définitivement pris le dessus sur le pèlerin (El Hadj) de nos rêves foot ?
Me demandes-tu en te le demandant à toi-même et aux autres. Je serais tenté de répondre : Rien. Ne faisons pas de El Hadj Ousseynou Diouf, un bouc émissaire, ni un exutoire. Pour le dire autrement, il est l’image grossie de l’homo sénégalensis, comme tu l’as si bien posé. Son double tort est de s’être fait prendre puisque nous avons élevé à la dimension d’un art la roublardise, la dissimulation et l’imposture doublées d’un culte démesuré des apparences, d’une part et son refus obstiné (ou son incapacité) à jouer le jeu : se permettre tout pourvu que les apparences fussent sauves, d’autre part.
Dans notre société la transparence éthique est proclamée, hurlée même et la vorace agressivité de cette vocifération est à l’exacte mesure de l’usurpation dont elle procède. Difficile donc de pardonner à Weuz - joueur - de ne pas jouer le jeu ; de nous renvoyer si brutalement à nous-mêmes, à nos petits principes et à nos grandes gueules. Haro sur le baudet !
Weuz aujourd’hui, le Joola hier ! Le tragique d’hier et le grotesque d’aujourd’hui procèdent ici de la même logique d’évitement, de déresponsabilisation sur fond de dé-cérébralisation. Les deux événements sont un condensé, un bouillon de culture saisissant de toutes les contradictions, de toutes les béances, de toutes les lâchetés, de toutes les duplicités, de toutes les hypocrisies, de toutes les incivilités, de toutes les turpitudes, de toutes les fausses connivences, de toutes les concussions dont nous avons fait notre lit et notre miel. Béances, lâchetés, hypocrisies, incivilités, fausses connivences, turpitudes, concussions que nous habillons d’aphorismes frauduleux et affriolants, de moralisme à la petite semaine, de proverbes approximatifs, de sentences définitives et de formules absconses. Reclus de petite sincérité et de grandes duplicités.
Fiers de nos prouesses verbales. Pour mieux masquer la vacuité d’une pensée couchée, glauque. Nous sommes loin du cas singulier de Weuz – partie émergée de l’iceberg dont le cas semble véniel par rapport à ce dont il est la révélation. Palimpseste et effet de miroir. L’épure. Weuz, d’une certaine manière, est notre insoutenable vérité. J’entends le hurlement de la meute des tartufes effarouchés ; je n’en ai cure : je suis résolu à l’outrepassement. Il y va de notre santé, de notre hygiène.
L’homo sénégalensis sait tout
L’homo sénégalensis sait tout ; quand on sait l’importance décisive de la prise de conscience de l’ignorance dans l’avènement de la Sagesse, on en est ébaubi. Oui, nous savons tout, de cette sotte sagesse dont Isaïe (29.14) se proposait déjà la destruction ! Il n’est pas besoin d’être un grand observateur, ni un grand clerc pour remarquer que nous ne savons plus conjuguer le verbe savoir à la forme négative. Dire : «je ne sais pas», c’est avouer qu’on n’est pas dans le coup : ce qui nous est proprement insupportable.
Toujours le faire-semblant. Nous avons dépris le mot de la concurrence des choses ; nous avons dressé les mots à occulter nos maux. Nous sommes en passe de devenir la première puissance mondiale de la Parole. Nous avons érigé, puisque c’est toujours la faute à l’autre, l’irresponsabilité, le renoncement intellectuel et l’affaissement éthique en vertus. Je conviens avec toi que Weuz est un prétexte. Il nous faut maintenant aller, au-delà du paratexte, au texte lui-même, à son contexte et hors-texte.
Je réitère ici le propos que j’avais tenu dans un précédent article que tu as rappelé, car je le maintiens : «je tiens les Sénégalais, je nous tiens comme responsables «du mal sénégalais» ; ce mal qui a rendu possible tout ce que nous dénonçons aujourd’hui rendant du coup notre pays improbable et lointain. Je dis sans équivoque, ni vaine hyperbole, que les Sénégalais constituent le principal problème du Sénégal.
Je dis : «les Sénégalais» pour aller vite, non pas dans une volonté de massification indivise, encore moins dans une hâtive et abusive généralisation, puisqu’il est difficile de demander à l’excellence de se manifester quand sa voix est noyée dans la clameur ; quand elle est tenue en laisse par une médiocrité gluante, reptilienne, prédatrice, lépreuse, intellectuellement trépanée, bruyante, hautaine, dangereusement habile «à découvrir le point de désencastration, de fuite, d’esquive» ; à habiller son inaptitude radicale d’aphorismes falsifiés et frelatés».
Pourtant, il y a des hommes et des femmes de valeur et de vertu dans ce pays : j’en connais qui sont de purs joyaux et dont j’espère que la voix croîtra quand la clameur décroîtra. Si l’aigle peut voler aussi bas que la poule, jamais la poule ne pourra atteindre les cimes qu’il taquine.
Travailler à rendre audible la voix de l’excellence constitue en l’état une tâche permanente.
Je tiens donc, cette réserve faite, les Sénégalais pour responsables et de la tragédie du Joola et des frasques alléguées de Weuz, car ils sont joueurs ; toujours en représentation : «ils jouent à» être patriotes, pieux, honnêtes, penseurs, politiques, travailleurs, intelligents etc., en florentins impénitents. Ils sont plus attentifs à leurs petits calculs, leurs vastes haines, leurs grandes jalousies, leurs petites mesquineries, leurs grandes manœuvres, leurs petites combines,- au bout desquels, il y a eu le Joola, version tragique et Weuz versant comique – noyés qu’ils sont dans leur égotisme sur-dimensionné, névrotique - tout préoccupés qu’ils sont par des logiques de salut individuel». De ces pratiques détestables, tu as donné un aperçu phénoménologique édifiant.
Personne n’est dupe, mais tout le monde fait semblant. L’important, et nous y sommes passés maîtres, est de contrôler notre image publique, spécialistes que nous sommes du grand écart, au risque de la déchirure musculaire, entre le propos public mensonger et les maladroites vérités de la rue. Ce jeu spéculaire gangrène le pays pis que la pire des plaies d’Égypte. Voici revenu – éternel retour du même – le temps du Pharaon de la Bible et du Coran et d’Ibn Obeyda à Médine, car si nous avions les qualités que nous excipons ostensiblement, à tout bout de champ, précisément parce que nous en sommes structurellement dépourvus, notre pays serait aujourd’hui «à la droite du Père» dans le concert des Nations.
Et il n’y aurait pas eu le Joola et Weuz n’aurait pas osé !
Non, nous ne sommes pas si beaux que ça, si solidaires que ça, si travailleurs que ça, si fraternels que ça, si patriotes que ça, si pieux que ça ; même les libres-penseurs ont de singuliers oublis. Il y a par exemple beaucoup de prieurs dans notre pays : il y en a combien d’authentiquement pieux ?
Le pire, c’est qu’il y a peu de monde pour s’indigner de ces pratiques qui jurent d’avec nos tonitruantes proclamations. Quand tout est aplani, quand toutes les choses se valent, alors aucune marge ne saurait brûler d’un rappel à l’ordre salvateur, car nous serons devenus entre-temps des amputés du cœur et des handicapés de l’espérance.
Pourquoi, mon Dieu, nous indigner des propos racistes de Stephen Smith qui nous taxe (nous les nègres) de structurellement incompétents (version moderne du mythe archaïque de Cham) si nos pratiques tendent à lui donner raison ? La réponse à Smith n’est pas devant les tribunaux pour injures raciales ni dans l’invective stérile, mais sur le terrain de l’intelligence et des pratiques rénovées qui en découlent.
Or nous le savons : Le Sénégal a honte de ses fils qui eux-mêmes sont honteux d’eux-mêmes, y compris les spécialistes de l’esquive et du désencastrage. J’ai l’intime conviction que ce Sénégalais-là est quelque chose à surmonter ; que rien n’est possible avec ce Sénégalais-là ; toutes les chances de notre pays demeurent intactes si un Sénégalais nouveau advenait à partir de la récusation et de la mort du «vieil homme».
En vérité l’homo sénégalensis ne s’aime pas. Ne s’aime plus ?
Il s’agit de faire volte-face, de nous faire face.
Notre société est une société violente, d’une violence sourde, diffuse et fielleusement intolérante. Fourbe et dissimulatrice. Il s’agit de faire volte-face ; de nous faire face. Sans fioriture, ni manœuvre dilatoire. De nous dire la vérité. Cela nous grandirait, cela aurait de l’allure. Notre pirogue chétive reprendrait de la vigueur pour affronter flots impétueux et vents contraires. Alors seulement nous songerions à l’avant-dire de nos nouvelles résolutions : nous écririons la post-face après.
Il ne s’agit pas dans mon esprit de nous faire un procès en sorcellerie mais d’une volonté de crever l’abcès. Sans compassion coupable pour nous. Si nous ne voulons pas de la pitié compassée des autres, il faut que nous soyons impitoyables avec nous-mêmes. Nous avons besoin de nous arc-bouter sur des valeurs revisitées, ancrées dans notre histoire et butinant le pollen fécond des vents ultramarins. Nous avons besoin de fraternelles utopies et de grands méta-récits : nous ne pouvons pas entrer dans la post-modernité en faisant l’économie de la modernité.
La postmodernité, par définition, est descriptive, contre-productive et fabrique des anti-modèles et des héros négatifs.
Babacar, et toi aussi «nous tous», dites-moi, à mon tour, qui, honnêtement, peut sans frémir jeter la première pierre à Weuz, exception faite de l’excellence muselée dont j’ai parlé plus haut ? Que déféré à la haute cour de la Conscience, je le relaxerai pour vice de procédure ou minorité pénale sans le disculper néanmoins et je nous inculperai. Sans présomption d’innocence !
Notre peuple est un peuple dramatique, au sens hugolien du terme. Son élite est à son image. Entre forclusion, spécularité et extraversion. Pour sauver le Sénégal, faut-il en venir à privatiser l’Etat, extrader l’élite et abolir le peuple ? Oui, certain soir de grande déréliction, me démangent des envies de privatiser nos Etats tropicaux et de dissoudre ce peuple qui ne veut pas se faire peuple et qui a, de toutes les impostures, fait le lit de son insoutenable légèreté d’être.
Peuple ? Il serait plus exact de parler de «foule criarde si étonnement passée à côté de son mouvement (…) à côté de son cri (…) si étrangement bavarde et muette».
Il faut, ici, être clair : je n’en veux pas à ce peuple mien. Je souhaite même l’ouverture de ses yeux sous des soleils printaniers de rédemption. Je suis seulement atterré par son refus (dans lequel les responsabilités de l’élite sont grandes) de se faire peuple en réintégrant une citoyenneté active et responsable dont l’alternance avait semblé donner quelques lueurs. J’en veux plus à nos élites d’arrière-garde dont la parole qui ne brûle plus se consume sans fin.
Ces élites – dont il faut assurément instruire sans complaisance le procès – sont-elles à notre image ou sommes-nous à leur image ? La question n’est pas vaine. Se la poser, c’est prévenir d’autres évitements : il n’y a pas d’une part des élites massivement coupables et une société résolument harmonieuse d’autre part qu’elles viendraient – ces élites – gangrener ! Du haut jusqu’au bas de l’échelle sociale, tout le monde (pour aller vite et prendre une métaphore simple) clignote à droite et tourne à gauche, comme nos chauffeurs de taxi et nos cars rapides sans marche arrière !
Nous pourrions obliger nos princes à être vertueux, si nous l’étions nous-mêmes. Résolument.
Où en suis-je ? «Ne me donnes pas d’indications de lieu», précises-tu.
A ceci :
La société sénégalaise est malade de ne plus savoir d’où elle vient ni où elle va. C’est cette maladie qu’il faudrait nommer si nous voulons avoir une chance de rémission ; d’autant que je pressens que ce que j’essaie d’articuler n’est que l’écume visible de cette maladie. Convenons donc d’appeler cette maladie, jusqu’à plus ample diagnostic, l’affaire de la société sénégalaise déférée au tribunal de sa conscience ; inculpée d’abandon axiologique, de renoncement idéologique, de pleutrerie politique, d’affaissement éthique, d’inconsistance spirituelle et de proxénétisme culturel.
Une société où triomphent l’hypocrisie (cet hommage que le vice rend à la vertu), la dissimulation, la recherche frénétique de l’argent ; une société qui révoque en doute ses fondements, foule au pied ses interdits fondateurs ; une société qui perd sa capacité d’indignation, oublieuse de son passé et tournée vers des valeurs délétères venues d’ailleurs, qui s’en drape, s’en vante au nom de maximes corrompues et d’une pseudo-modernité importées et adoptées sans discernement ; est une société profondément, grièvement, incontestablement malade.
Et à ceci encore :
L’in-quiétude, vois-tu mon vieux, m’habite désormais sans désemparer. Je suis entré en Résistance, face à la tentation de l’ellipse. Moi qui suis revenu «lisse et jeune dans ce pays viscéralement mien le cœur bruissant de générosités emphatiques».
Que faire ?
Que faire ? Vaste programme ! Pour les gens de notre génération cette question est fortement surdéterminée et nous renvoie à nos années de braise, à nos générosités antiques, à notre foi d’airain de jadis déjà et dont la nostalgie m’étreint de nouveau. Mais je ne céderai pas aux sirènes de nos mémoires attendries et reconstruites, car la question, plus qu’hier, est d’une singulière acuité, actualité.
Tu me demandes de te dire ce qui frappe à la porte des générations après nous. Qu’est-ce qui va leur échoir ? Qu’est-ce que nous leur transmettrons ? Je suis comme toi, Vieux, je m’interroge à haute voix, dans un questionnement polyphonique. Je pressens néanmoins que ces générations courent de graves dangers s’il n’est pas mis fin à cette sulfureuse engeance, si nous ne nous empressons pas «de mettre nos âmes en lieu sûr».
Je sais aussi qu’aucune pirouette-prouesse verbale, aucune dénégation ne nous sauvera d’un naufrage annoncé. Comme les civilisations, qui sont mortelles, une société peut être forclose. Il nous faut désormais bien réfléchir avant de demander aux miroirs de nous réfléchir. Il nous faut avec le poète revenir à la hideur désertée de nos plaies, loin de nos tragiques futilités, réapprendre à nous aimer, reprendre possession de nos ambitions, de nos cœurs et de nos espérances. Lucidement, sans coupable complaisance.
Il nous faut, si nous voulons donner quelques chances de survie à ce pays que nous avons en partage, sortir de l’ambiguïté culturelle (juxtaposition – et non symbiose – de l’Occident et de l’Afrique : nous sommes tantôt Occidentaux, tantôt Africains au gré de nos intérêts particuliers), c’est-à-dire de cette sorte de «substantification» des attitudes ; pour une culture authentique, enracinée et ouverte, dynamique. Or nous sommes entre deux eaux, semblables à l’hyène qui veut naviguer sur deux pirogues à la fois.
Comme je l’ai dit ailleurs, il n’y a pas de destin forclos ; il n’y a que des volontés molles et des responsabilités désertées. La responsabilité et la liberté ne se délèguent point. Et la résolution des maux qui nous gangrènent, dont les effluves de la pestilence offusquent nos narines, exige la totalité de nos efforts ; que de notre aptitude d’abord à bien les penser dépendra notre capacité à inventer un futur habitable, un Sénégal enfin réconcilié avec lui-même.
Il y a une urgence éthique dans ce pays.
Que Dieu nous aide, nous préserve et nous sauve.



























