Patriotes ou délinquants ?
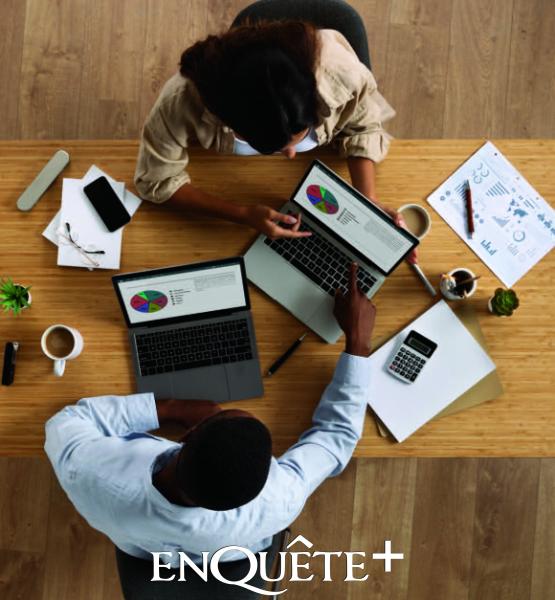
Depuis septembre 2024, on ne parle que de l’affaire de la dette dite cachée du Sénégal. Pendant que les politiciens se renvoient la faute, les fonctionnaires, qui sont au cœur de ce scandale, restent, eux, dans leur coin, tenus par l’obligation de réserve.
La charge politique et émotionnelle a fini par prendre le dessus sur le volet purement technique. Depuis l’éclatement de ce qu’il est convenu d’appeler le scandale de la dette, une guerre impitoyable s’est déclenchée entre l’ancien et l’actuel régime, les parties se renvoyant respectivement la faute. Jusque-là, il y a une partie que nous n’entendons pas du tout. Pourtant, elle est au cœur de ce scandale présumé. Il s’agit des hauts fonctionnaires du ministère des Finances et du Budget ainsi que des institutions de contrôle comme la Cour des comptes.
Si problème il y a dans la tenue des comptes publics, la responsabilité de ces techniciens ne saurait être éludée. On a beau haïr l’ancien Président, ce n’est pas lui qui manipulait les comptes, même si sa responsabilité politique peut être interpellée. La preuve, il est parti depuis le 2 avril 2024, mais les problèmes persistent dans notre administration. Ce qui justifie en grande partie les blocages dans les discussions avec le Fonds monétaire international (FMI), qui ne cesse d’appeler à des mesures correctrices.
Lors de sa dernière mission, à la fin du mois d’août, l’institution de Bretton Woods parlait de “problèmes systémiques identifiés par la Cour des comptes” et qui ont été à l’origine d’importantes déclarations erronées. Elle informait, en même temps, que les discussions se poursuivaient autour des mesures correctrices destinées à traiter les causes profondes de ces déclarations erronées.
Il résulte des constats du FMI une absence de centralisation des fonctions de gestion de la dette, une absence de base de données centralisée de la dette, des manquements dans le rôle du Comité national de la dette publique, des dysfonctionnements dans le contrôle des engagements budgétaires, ainsi qu’un problème de consolidation des comptes bancaires de l’État dans le cadre du Compte unique du Trésor.
Et si on écoutait les fonctionnaires s’expliquer sur les pratiques à l’origine de ce misreporting
Voilà, entre autres causes profondes, à l’origine de cette situation exécrable de nos finances publiques, qui, du reste, a souvent été évoquée par la Cour des comptes dans divers rapports. Mais jusque-là, seuls les politiciens et le FMI se prononcent. Alors que les premiers ont tendance à politiser le dossier à outrance, le FMI, pour sa part, tente plutôt de sauver sa peau et de dégager sa responsabilité dans la situation actuelle. Les fonctionnaires, eux, on ne les entend pas du tout, sous le prétexte de l’obligation de réserve.
À la publication du rapport de la Cour des comptes, le Syndicat unique des travailleurs du Trésor (SUTT) avait menacé de tenir un point de presse. La structure prévoyait ainsi une mise au point sur le rapport. “Cette rencontre avec la presse est une occasion pour le SUTT de faire une mise au point, suite à la publication du rapport de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques”, pouvait-on lire dans le document. Mais après un concours de circonstances, le point de presse a finalement été annulé. EnQuête revient ici sur certaines confidences relatives aux pratiques à l’origine de ce grave problème de misreporting.
Sur la non-comptabilisation de la dette bancaire locale
La première précision que les experts ont tenu à apporter est liée à la définition même de la notion de dette publique.
La dette publique, précisait un de ces fonctionnaires, est constituée de deux composantes : la dette intérieure, consistant en l’émission de titres publics (bons et obligations du Trésor) au sein des marchés financiers régionaux ; la dette extérieure, consistant en des prêts contractés auprès d’organismes bilatéraux et multilatéraux ainsi que des prêts contractés aux conditions du marché (levée de fonds sur les marchés financiers internationaux, etc.).
Sur la base de ce constat, que les spécialistes pourront apprécier, les régies ont toujours eu un traitement différent d’une partie de la dette contractée auprès des banques locales, qu’ils présentent comme des “facilités financières obtenues auprès des banques locales pour notamment l’exécution de projets, programmes et opérations spécifiques”.
Pour nos interlocuteurs, ces facilités ne sont pas des émissions de titres publics. Raison pour laquelle, au lieu de les comptabiliser dans la dette et de grever les indicateurs, elles ont fait l’objet de programmations budgétaires pour leur paiement.
Aussi, soulignaient-ils pour réfuter l’idée d’une dette cachée, “l’exposition de l’État auprès des banques locales est disponible dans les rapports de la BCEAO.”
Il convient de souligner que M. Al Aminou Lo, actuel ministre d’État et ancien directeur national de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, a dit récemment qu’il arrivait que la BCEAO soit dribblée. Le même Al Aminou avait dit, par le passé, qu’il était au courant de certains dysfonctionnements et avait même alerté en son temps.
Dans tous les cas, sur la programmation budgétaire de cette dette ou de ces facilités bancaires dans les différentes lois de finances, les affirmations restent bien vérifiables. Les spécialistes des finances publiques peuvent apprécier la légalité ou non des arguments avancés.
Sur la non-comptabilisation des emprunts-projets
Outre la dette bancaire locale, les prêts-projets financés sur ressources extérieures constituent l’autre grande source de la dette dite cachée. Là également, les mêmes procédés ont abouti aux mêmes divergences.
Selon nos interlocuteurs, il faut, dans ce cas, décortiquer les mécanismes, procédures et interventions des structures de l’État et des bailleurs, pour comprendre comment la machine a fonctionné.
Sur la procédure, expliquent-ils, l’État contracte des prêts auprès des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) pour la mise en œuvre de projets et programmes de développement (PUDC, Promovilles, autoroutes Mbour-Fatick-Kaolack, etc.).
Ces prêts sont mobilisés à travers la Direction de l’Ordonnancement des Dépenses Publiques (DODP) du ministère des Finances et du Budget, qui en assure l’ordonnancement auprès des partenaires.
Les demandes de paiement des projets et programmes sont soumises à la DODP par les entreprises. À ce moment seulement, la DODP saisit le partenaire aux fins de paiement de la dépense.
Là également, difficile, selon nos interlocuteurs, de parler de dettes cachées. Car tout est retracé dans les différentes lois de finances. Seulement, au lieu de les mettre dans la partie “dettes”, ces tirages sont comptabilisés en emprunts-projets dans la catégorie des dépenses en capital sur ressources externes.
L’autre pratique, encore plus discutable pour les spécialistes, c’est qu’il arrivait qu’une partie de ces tirages fasse l’objet de reports dans la comptabilisation. Par exemple, des tirages de l’année N sont comptabilisés dans les livres de l’année N+1.
Au-delà de ces arguments avancés par les fonctionnaires, se pose le problème de la publication du rapport Mazars, qui a fait un diagnostic exhaustif de la situation. Interpellé sur France 24 il y a quelques jours, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait renvoyé la balle au FMI. À la question de savoir si l’audit du cabinet Mazars sera rendu public, il a déclaré : “Ce n’est pas notre audit. Si le FMI mène un audit, c’est à lui d’assumer la publication ou la non-publication.”
MOR AMAR























