Pour apparaitre dans les radars des classements mondiaux….
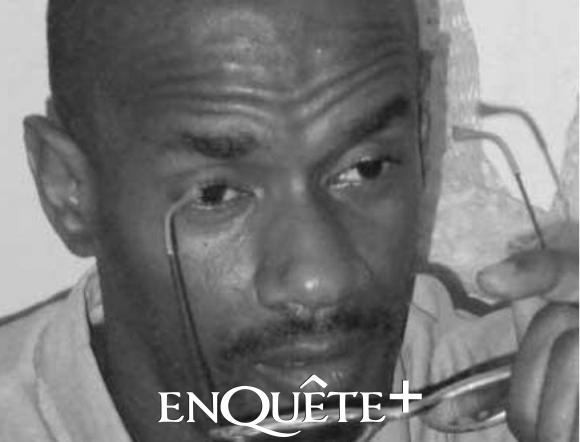
C’est le 15 août dernier, à quelques jours de la rentrée des universités en Occident, que la treizième livraison du Classement de Shanghai des universités dans le monde (ou Academic Ranking of World Universities) a été publiée. Depuis la première édition, en 2003, de ce palmarès qui établit le rang des cinq cents « meilleures » universités dans le monde (sur un total de 17.000 institutions), la logique concurrentielle s’est considérablement accentuée dans l’enseignement supérieur et dans la recherche scientifique dans le monde. Et depuis la première édition aussi, d’autres classements sont nés.
Les pourfendeurs du Classement de Shanghai ont beau dire que c’est un outil taillé sur mesure pour les Anglo-Saxons, mais quand leurs institutions progressent dans le classement, ils sont les premiers à s’en féliciter. D’une façon générale, que l’on se montre favorable au classement ou qu’on le pourfende, la forte pression internationale qui pèse sur l’enseignement supérieur depuis plusieurs années, notamment à cause de la mondialisation, de la circulation accrue des savoirs et de la concurrence entre les pays, est telle que les classements des universités ne peuvent plus être ignorés.
Et puis, le Classement de Shanghai a beau être établi par l’Université Jiao Tong, il n’en est pas pour autant favorable aux universités chinoises. Le classement est effectué suivant six critères : le nombre de prix Nobel et de médailles Fields obtenus par les chercheurs affiliés à l’institution et même ceux obtenus par ses anciens étudiants, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline, le nombre d’articles publiés dans des revues scientifiques telles que Nature et Science qui ont une réputation mondiale, le nombre d’articles indexés dans Science Citation Index, le nombre d’articles indexés dans Arts & Humanities Citation Index, la « performance académique » par rapport à la taille de l’institution. L’idée souvent avancée qu’aucun crédit n’est accordé à la qualité de l’enseignement et au niveau des étudiants est erronée, étant donné que le tout premier critère, qui tient compte des distinctions obtenues par les anciens étudiants formés à l’université en question, permet d’en juger.
En règle générale, les distinctions internationales qui donnent un rayonnement mondial sont propres à faire entrer une institution dans les radars des classements des universités, notamment celui de Shanghai. C’est ainsi que la Toulouse School of Economics figure parmi les promus de cette année, en entrant dans les 300 premières places grâce au prix Nobel d’économie attribué à l’un de ses enseignants, Jean Tirole, en 2014.
Aussi, dans la quinzaine de classements apparus depuis la première livraison, ce sont toujours les mêmes vingt qui caracolent en tête : Harvard, Stanford, M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology), U. C. Berkeley… Ce n’est pas un hasard si ces institutions se taillent la part du loin dans les prix Nobel et autres distinctions à l’échelle mondiale ; ce n’est pas un hasard non plus si elles se trouvent être en même temps les plus prestigieuses universités aux Etats-Unis d’Amérique. Ce sont des institutions qui brassent beaucoup de ressources financières et beaucoup de ressources humaines, les unes et les autres s’alimentant mutuellement.
Concernant les universités de langue française, l’Université Pierre-et-Marie Curie (UPMC) arrive à la 36ème place du Classement de Shanghai 2015. A ce rang, elle est la 1ère université française. Il est vrai que le classement a tendance à favoriser les universités de grande taille, multidisciplinaires, au détriment des petites institutions qui travaillent en réseaux. C’est bien probablement ce qu’ont compris les autorités universitaires françaises qui progressivement vont vers des projets de fusion. Autrement, comment interpréter le projet de rapprochement entre les deux fleurons de l’université française, Pierre-et-Marie-Curie la 1ère université française et la Sorbonne l’université française la plus connue dans le monde, un rapprochement visant à mettre sur pied un nouvel établissement qui devrait voir le jour en 2018 et compter quelque 54.000 étudiants, 3390 enseignants-chercheurs et 2211 chercheurs.
En créant une université unique, à partir de la fusion de ces deux universités, les autorités des universités françaises ne cherchent pas autre chose qu’une plus grande visibilité internationale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en France. Ce qui fait cette visibilité, ce ne sont pas les gros effectifs d’étudiants et de personnels, ce n’est rien d’autre que la qualité de la recherche conduite, et la pluridisciplinarité qui jette des passerelles entre les facultés et entre les centres de recherche, et par conséquent entre les disciplines et entre les savoirs.
Fait notable, la fusion à venir entre deux grandes universités françaises va être une première depuis les évènements de mai 1968 ayant abouti à l’éclatement de l’université de Paris en plusieurs établissements. En attendant 2018, d’autres universités françaises ont déjà franchi le pas : en 2014, l’université de Bordeaux a été créée à partir de la fusion des universités Bordeaux-I, Bordeaux-Segalen et Bordeaux-IV ; en 2009, l’université de Strasbourg a initié le mouvement à partir du rapprochement des universités Louis Pasteur, Robert Schuman et Marc-Bloch.
Dans le sens inverse, la création d’une université américaine comme Yale (11ème dans le classement) est connue comme étant la première manifestation d’éclatement et de concurrence entre les universités américaines : ce sont des anciens de Harvard déçus par les orientations trop modernistes à leur goût que prenait l’institution qui sont allés fonder Yale. Une concurrence rude et stimulante est ainsi née entre les deux institutions qui chacune de son côté peut aujourd’hui légitimement se targuer d’avoir produit les élites les mieux formées dans le pays, notamment en sciences juridiques, tout comme par exemple deux autres institutions (Princeton et University of Chicago) qui se disputent la suprématie dans la recherche en sciences économiques au plan mondial, à tel point que depuis plusieurs décennies c’est presque exceptionnellement qu’un enseignant qui n’est ni de Princeton ni de University de Chicago décroche le Nobel d’économie.
L’éclatement des universités n’est donc pas forcément source d’efficacité, et le gigantisme n’est pas non plus un handicap. L’essentiel c’est de doter les ressources humaines des universités des ressources matérielles et financières indispensables pour rendre la recherche scientifique compétitive au plan mondial, au-delà de nos cadres et structures, au-delà du CAMES et de ses normes, très en deçà, trop en deçà des normes des meilleures universités occidentales, en dépit des moyens qui sont sans commune mesure.
Autrement, les meilleures universités américaines continueront à se croire plus dignes de nos meilleures ressources humaines dans les domaines du savoir où elles présentent des insuffisances : en particulier certaines spécialités des sciences sociales et humaines, mais aussi les maladies infectieuses et tropicales. Il n’y a pas de secret : ce que les universités américaines offrent de plus, ce ne sont pas tant les salaires que des conditions de travail nettement meilleures : des effectifs contenus et maitrisés, un véritable écrémage par une sélection plus rigoureuse car l’enseignement supérieur est par essence élitiste et par conséquent nullement destiné au plus grand nombre, des structures adéquatement équipées, une animation scientifique soutenue et motivante, en somme un environnement plus propice à l’épanouissement des ‘cerveaux’ et donc plus stimulant pour la réflexion, la recherche, et la production intellectuelle.
Malgré la logique concurrentielle implacable dans l’enseignement supérieur, le continent africain peut bien avoir une carte à jouer, car aucune université au monde, y compris les plus prestigieuses en tête de tous les classements (Harvard, Stanford, M.I.T.), ne peut se vanter de faire preuve d’excellence dans tous les domaines du vaste champ du savoir. Sans aucun doute, les ressources humaines permettant d’arriver à des productions scientifiques de qualité répondant aux véritables besoins de bien-être et d’épanouissement de nos populations ne manquent pas dans nos pays africains. Mais les crédits alloués à la recherche restent dérisoires sinon inexistants et l’environnement pour la recherche y est très défavorable. La où la recherche scientifique de qualité prospère, il est indispensable d’être libéré de contraintes matérielles. Ce sont des institutions qui valorisent l’innovation, encouragent la mobilité indispensable à la circulation des idées et des savoirs, et privilégient le sens de la productivité et l’obligation de résultats en prenant en charge dans l’équité, la transparence et l’efficacité les requêtes légitimes d’ordre académique des enseignants et chercheurs.
Cette année, le prix Nobel de médecine a été attribué à trois chercheurs dont l’un a travaillé sur le traitement du paludisme. Ils sont d’origines américaine, japonaise et chinoise. A l’analyse, on est à la fois enthousiasmé de voir que le paludisme auquel le continent africain a payé un lourd tribut au cours des décennies pourrait devenir un mauvais souvenir, mais on est en même temps quelque peu dépité que la découverte d’un vaccin contre le paludisme ne vienne pas de chercheurs du continent africain. Car en vérité, c’est à nos chercheurs en médecine qu’il revenait de relever le défi redoutable et combien exaltant de découvrir le vaccin contre le paludisme. Comme avec le paludisme, le vaccin contre le virus Ebola aurait dû aussi venir de nos chercheurs en médecine. Au contraire, face à l’épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola, on a vu les gouvernements des Etats africains les plus touchés faire appel au soutien financier des pays étrangers et à l’ingénierie médicale des pays occidentaux pour lutter contre la propagation du virus.
Il nous semble que l’expansion de l’épidémie n’est autre que la manifestation sanitaire des mauvaises politiques qui détruisent les corps sociaux dans nos pays. Et pour cela, pas plus hier qu’aujourd’hui et demain il ne suffira de faire appel à l’aide médicale et financière extérieure, ou de promouvoir des campagnes de publicité et de sensibilisation des populations pour enrayer la pandémie. Le fait est que ce sont les ressources aussi bien financières qu’humaines qui devaient aller à la recherche scientifique, à la production intellectuelle, à sa conversion pour le développement endogène de nos sociétés et le mieux-être de nos populations qui sont détournées et dévoyées.
Il importe de noter que là où Ebola est apparue et s’est rapidement propagée, c’est dans des pays (Guinée, Libéria, Sierra-Léone, RDC) où avaient prospéré des politiques de prédation ayant créé et alimenté des guerres civiles qui ont mis à plat toutes les structures et infrastructures. C’est ce qui a fait le lit de la diffusion et de l’expansion du virus. Cela signifie qu’à l’opposé, un Etat organisé mettrait l’accent sur la recherche scientifique permettant de découvrir le vaccin. Si le virus s’est diffusé et propagé comme on l’a vu, ce n’est pas uniquement que les services de santé ne sont pas adéquatement outillés, qu’ils manquent cruellement des moyens humains et techniques indispensables pour combattre un virus contre lequel il n’existe pas encore un vaccin, c’est aussi que les insuffisances en infrastructures et les déficits en ressources humaines de qualité sont les indices d’une faillite des politiques.
Une recherche scientifique compétitive au plan mondial qui tout en apportant de la valeur ajoutée à l’économie d’un pays contribuerait au rayonnement de ses universités et même au rayonnement du pays dans son ensemble ne peut relever du hasard. Un exemple : depuis la fin de la Seconde Grande guerre, un grand nombre des activités de recherche et de développement (notamment en informatique et en microbiologie) aux Etats-Unis d’Amérique correspondent à des objectifs de politique étrangère du gouvernement fédéral américain, visant à créer entre autres produits des techniques de détection et de surveillance toujours plus sophistiquées.
C’est ce qui fait que les travaux menés par des organismes de recherche privés intéressent l’Etat américain qui y est non seulement consommateur et client, mais aussi tout à la fois bailleur (en octroyant des subventions aux organismes de recherche en fonction de leur valeur intrinsèque pour les objectifs visant à renforcer la puissance industrielle et militaire du pays), régulateur et directeur de programme. Cependant, ces différents intérêts montrent non pas un interventionnisme du gouvernement fédéral américain dans le cadre de la recherche qui doit impérativement relever d’esprits libres, mais plutôt tout son souci pour l’efficacité de la recherche mise au service de la puissance du pays.
En vérité, ce sont des entreprises et des laboratoires privés qui, avec l’appui du gouvernement fédéral américain, ont été à l’origine des principaux travaux de recherche, d’élaboration et d’exécution des programmes spatiaux qui depuis la fin de la Seconde Guerre présentent des enjeux de politique étrangère très élevés pour l’Etat américain. Et c’est de cette façon qu’en étant à la pointe de la recherche scientifique, l’Etat américain peut assouvir ses ambitions de puissance dans la conduite des affaires internationales.
Nos Etats devraient pouvoir fédérer nos ressources humaines dans des structures supranationales de qualité, insoumises aux contingences politiques et aux intérêts nationaux étriqués, et les doter des moyens adéquats permettant d’arriver à des productions scientifiques de valeur qui répondraient en même temps aux besoins cruciaux de nos populations, non seulement dans le court et moyen terme mais dans un souci de prospective et d’anticipation jusque dans le long terme. En somme, il est question de faire entrer nos universités dans la course.
Abou Bakr MOREAU, Enseignant-chercheur, Etudes américaines, FLSH, UCAD, Dakar


























