Le Sénégal doit élargir et renforcer son cadre réglementaire
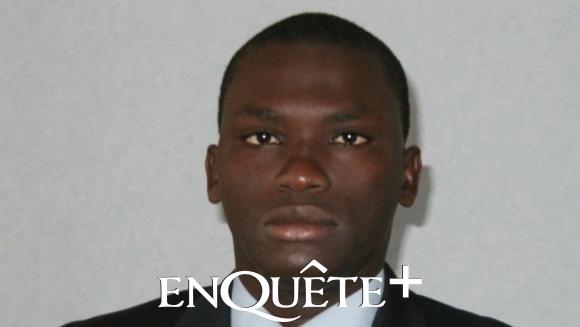
Il importe tout d’abord de faire une brève présentation du rapport Doing Business et d’expliciter le fondement théorique sur lequel il repose. Ce rapport est publié chaque année, depuis 2003, par le groupe de la Banque mondiale – la Banque mondiale et la Société financière internationale (SFI). Il permet, à travers les indicateurs utilisés, d’analyser les résultats économiques des pays et d’identifier les réformes efficaces relatives à la réglementation des affaires. Le rapport de 2012 a introduit la notion de distance de la frontière, qui est une mesure absolue de l’efficacité du cadre réglementaire des affaires. Le score des pays varie théoriquement de 0 à 100, 100 étant la frontière. Ainsi, « la frontière représente les meilleures performances réalisées par les économies sur chacun des indicateurs Doing Business depuis 2003 ou depuis l’année de la première collecte de données pour l’indicateur concerné. » (Rapport Doing Business 2014, p. 4).
Pour le rapport 2014, le classement sur la facilité de faire des affaires est effectué à partir du calcul d’une moyenne simple concernant 10 des 11 domaines de réglementation étudiés. Parmi ces domaines, on peut citer la création d’entreprise, le transfert de propriété, l’exécution des contrats, la protection des investisseurs et l’obtention de prêts. On peut aussi classer les pays selon chaque domaine.
La logique théorique qui sous-tend ce Rapport demeure les droits de propriété – concept proposé par l’école de Virginie dont les auteurs les plus connus sont James Buchanan, prix Nobel en 1986, et Ronald Coase, prix Nobel en 1991. Pour cette école, c’est le droit qui fonde l’efficience économique. L’objet de la loi est de garantir le respect des droits de propriété – leur définition et leur attribution – mais aussi d’établir des principes clairs de responsabilité – protection des droits – et de la liberté contractuelle – transfert des droits. Dans un régime de liberté, le droit permet ainsi de pallier aux déficiences du marché et donc de minimiser les coûts de transaction. Dans cette perspective, la performance des économies – maximum de gains à l’échange – s’explique par la mise en place d’un ensemble de règles procédurales pertinentes, c’est-à-dire qui favorisent l’épanouissement de l’initiative privée.
D’après le Rapport « Doing Business 2014 : Comprendre les réglementations pour les petites et moyennes entreprises », fondé sur des données actualisées en date du 1er juin 2013, le Sénégal s’est classé 178e sur 189 pays. Il s’agit, de prime abord, d’un mauvais classement par rapport au précédent Rapport (176ème sur 185). Bien que critiquable sur le fond – choix des indicateurs (pourquoi pas d’autres ?) et leur nombre – et sur la méthodologie – recours à une moyenne simple (pourquoi pas une moyenne pondérée qui tiendrait compte de l’importance relative de chacun des indicateurs ?), le rapport Doing Business demeure néanmoins une référence mondiale, un baromètre pour les investisseurs étrangers. Ainsi, la publication de ses résultats peut grandement influencer ces derniers.
La promptitude de la réaction des autorités sénégalaises est à la hauteur de leur inquiétude quant à l’évolution future des flux d’investissements directs étrangers. Elles ont contesté ce classement en arguant que certaines réformes n’ont pas été prises en compte. Pourtant, en termes absolus, le Sénégal a enregistré une progression régulière de son score depuis 2006. Mieux, le Sénégal fait partie des 50 pays qui ont le plus réduit la distance de la frontière depuis 2005 (il est classé 27ème devant le Maroc notamment, Tableau 1.7 du rapport, p. 17). Mais, en termes relatifs, les autres pays ont réalisé des performances meilleures que celles de notre pays, d’où son recul au niveau du classement. Le Sénégal doit donc s’évertuer à renforcer et élargir son cadre réglementaire pour rendre davantage attrayant son environnement des affaires.
Pr Seydi Ababacar Dieng, Directeur du Laboratoire de Recherches Économiques et Monétaires (LAREM) Enseignant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal.

























