Une analyse historique des blessures de Dakar
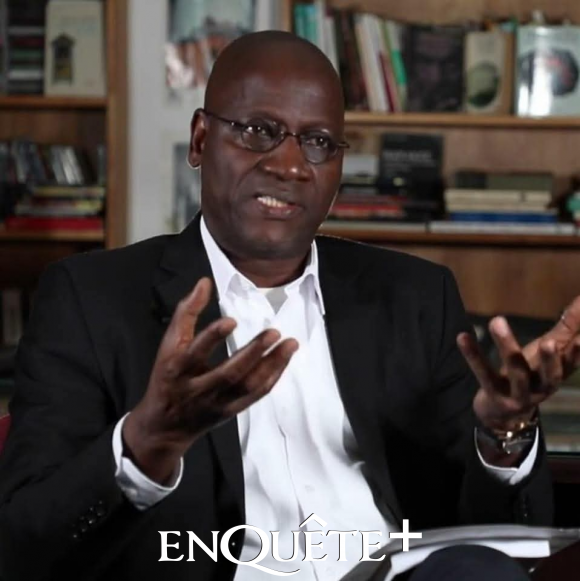
A l’image de « Rhodes must fall », nous assistons au Sénégal à une politique de l'oubli qui affecte le patrimoine urbain de Dakar, ancienne capitale de l’Afrique occidentale française. En nous appuyant sur l'exemple de la destruction d'édifices emblématiques de l’empire, nous lisons l'histoire dans la pierre. Au-delà d’une simple question esthétique, le patrimoine urbain est intrinsèquement lié à la présence mémorielle de l’histoire coloniale et au lien entre la ville et ses occupants. La décolonisation des imaginaires doit s'accompagner d'une politique culturelle urbaine globale, respectueuse de l'histoire plurielle de la ville. Il met également en lumière la persistance de logiques ségrégatives, de l'époque coloniale à l'ère post-indépendance, qui continuent de façonner l'espace dakarois et d'engendrer ses "blessures" urbaines par la gentrification et la réécriture de l’histoire de l’espace urbain.
En effet, la ville, en tant que construction spatiale et sociale, est un palimpseste où se superposent et s'inscrivent les strates de l'histoire humaine. L'architecture, les monuments, les places publiques et les espaces de vie et de culte sont autant d'expressions tangibles des sociétés qui les ont façonnés. Ils révèlent non seulement l'exercice du pouvoir public, mais aussi la vie quotidienne des populations. La Renaissance européenne, par exemple, illustre cette volonté de restaurer et de faire revivre les traditions gréco-romaines à travers les arts et l'architecture, soulignant la dimension mémorielle inhérente à la pierre. Cependant, dans le contexte urbain sénégalais, et plus particulièrement à Dakar, la prise en compte de cette dimension patrimoniale dans les politiques publiques d'aménagement urbain semble malheureusement déficiente. Alors que le débat sur le déboulonnage des statues coloniales agite les sphères publiques sénégalaises et mondiales, il est impératif de dépasser le "populisme mémoriel" et la confusion entre histoire et mémoire pour envisager une refonte des villes sénégalaises dans le cadre d'une politique culturelle globale, qui intègre leur histoire particulière et leurs lieux de mémoire.
L'effacement du patrimoine architectural colonial dakarois
Le processus de défiguration et d'effacement du patrimoine historique de Dakar est souvent décrié les communautés d'historiens, d'architectes et de conservateurs du patrimoine. Ces professionnels se trouvent malheureusement réduits à un rôle de "Cassandre", contraints de déplorer chaque effondrement d'un monument. Cette destruction méthodique ne se contente pas d'altérer le paysage urbain ; elle mutile des pages entières de l'histoire de la ville.
Si la décolonisation des imaginaires est une nécessité contemporaine, il est tout aussi crucial de ne pas essentialiser les cultures africaines. Une lecture romantique, fondée sur une fiction d'une culture africaine éternelle aux caractéristiques figées, est à proscrire. L'Afrique, à l'instar de tous les continents, est un espace ouvert, caractérisé par des expressions culturelles plurielles, fécondées au cours de l'histoire par de multiples apports internes et externes.
Le style architectural colonial de Dakar, notamment le néo-soudanais, illustre ce long cheminement historique et ces choix politiques délibérés. Ce style visait à construire une identité urbaine liant la colonie à la Métropole, transformant Dakar en une vitrine internationale de l'administration coloniale. Les premiers édifices coloniaux, tels que le palais du Gouverneur (1908) et l'Hôtel de Ville (1914), furent initialement construits dans un style néo-classique. Parallèlement, un style orientalisant néo-mauresque, en usage en Afrique du Nord, fut employé pour des bâtiments comme la caserne de la Marine (1911), le Marché Kermel (1907-1910, détruit puis reconstruit en 1993) et la Gare du chemin de fer (1910-1914). Le choix de ce style architectural répondait à une quête d'historicité, cherchant à établir un lien symbolique et visuel entre le pouvoir colonial et le territoire colonisé en rattachant la capitale impériale à la lointaine histoire du Soudan médiéval. La réinterprétation de la Grande Mosquée de Tombouctou, dont la construction remonte au moins au XIVe siècle, se retrouve ainsi dans divers édifices publics dakarois, dont la Polyclinique Roume (1931), le marché Sandaga (1935), l'hôtel de l'administrateur de Dakar (1931, reconverti en musée Théodore Monod en 1936), la maternité de l'hôpital Central indigène (1919, devenu l'hôpital Aristide Le Dantec), et l'Institut Pasteur de Dakar. Ce style, généralisé à l'ensemble de l'Afrique occidentale Française (AOF), s'est même associé au style néo-byzantin de la cathédrale de Dakar. Pour concrétiser cette vision architecturale, des concours d'architecture furent organisés et des emprunts mobilisés, conférant à Dakar sa physionomie particulière.
Malheureusement, les témoins de cette histoire urbaine sont aujourd'hui méthodiquement démantelés. La destruction du marché Sandaga à la veille de la fête de la Tabaski, suivie de celle de la Maternité de l'hôpital Aristide Le Dantec à la veille de la Coupe du Monde de football, illustre cette politique d'effacement. Ces démolitions, souvent réalisées dans la discrétion, génèrent un sentiment de "forfait honteux" et soulignent l'absence d'une vision cohérente et responsable de l'aménagement urbain. La politique de la ville ne saurait se réduire à la simple débaptisation de noms de rues, à l'édification de tours de verre ou de statues d'inspiration stalinienne. L'attachement à une ville ou un village procède de l'intériorisation de son histoire, des souvenirs multiples, des sonorités et des liens invisibles qui unissent les vivants et les morts aux lieux. Pour tous ceux qui sont nés à la maternité de l'hôpital Le Dantec, la destruction de ses murs est synonyme d'une déchirure profonde.
L'héritage architectural du président Léopold Sédar Senghor, marqué par le "parallélisme asymétrique", offre un contre-exemple notable. Des réalisations comme les "Dents de la mer" (1973-1975), conciliant les styles inspirés de Djenné et de Tombouctou, le Campus de l'Université Gaston Berger, ou l'ambassade du Sénégal à Brasilia, témoignent d'une tentative de conciliation entre tradition et modernité. Le Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES) est un autre exemple, dont la pérennité est menacée par les projets de promoteurs immobiliers.
Les villes dans la ville : De la ségrégation raciale à la ségrégation par l'avoir
Dakar, à l'instar de nombreuses villes coloniales, fut conçue comme un espace de ségrégation raciale. Les Européens étaient cantonnés dans les quartiers du "Plateau" (Dakar-Plateau, Kayes-Plateau, Abidjan-Plateau), tandis que les populations africaines étaient maintenues à distance dans des "villes indigènes », pour préserver la santé des colons. Entre Dakar et la Médina, l'actuel quartier Rebeuss, peu urbanisé, était réputé non aedificandi, la prison centrale de Rebeuss étant implantée dans cette zone tampon pour rappeler au peuple le pouvoir de "surveiller et de punir". Des règlements d'urbanisme et sanitaires furent édictés pour ségréger les populations lébous : interdiction de construire en pisé, incendies des cases indigènes au moindre cas de maladie contagieuse, interdiction de piler ou de se livrer à des cérémonies festives bruyantes.
L'épidémie de peste de 1914 servit de prétexte à la création de la Médina de Dakar et au relogement des populations africaines. Une zone non constructible fut établie entre la ville européenne et la Médina, et les infrastructures mises en place répondirent à cette politique. Les camps militaires de Mangin et Archinard, à la périphérie de la ville européenne, furent érigés pour faciliter les cordons sanitaires et les quarantaines des "indigènes". Un dispositif similaire de pont-levis fut instauré à Abidjan entre le Plateau et Treichville.
L'hôpital Central Indigène, inauguré en 1914, fut dédié aux soins des tirailleurs et des populations indigènes, tandis que la Polyclinique Roume, inaugurée en 1932, constituait également une véritable sentinelle de surveillance de l'état de santé des populations africaines. Ces deux institutions jouèrent un rôle crucial dans la formation des premiers médecins africains. L'École de médecine de Dakar, premier embryon de l'enseignement supérieur en AOF, fut hébergée dans l'enceinte de l'hôpital Central Indigène de sa création en 1918 jusqu'en 1931, avant d'être transférée au Rond-point de l'Étoile, dans les locaux actuellement occupés par l'Institut Africain de Développement Économique et de Planification (IDEP). Des personnalités telles que Félix Houphouët-Boigny y firent leurs études. La salle qui servait de morgue et de salle de dissection pour les étudiants existe encore aujourd'hui.
L'instrumentalisation des crises sanitaires par les politiciens (notamment Blaise Diagne en 1914) conduisit le gouverneur général de l'AOF à séparer la ville de Dakar de la colonie du Sénégal, en créant la circonscription de Dakar et dépendances en 1924, qui devint la Délégation de Dakar en 1946. La politique de déguerpissement se poursuivit dans les années 1950 avec la création de Grand Dakar et de Pikine Dagoudane.
Senghor et la "ville interdite"
Au moment de l'indépendance, les politiques urbaines de Dakar conservèrent, hélas, les mêmes perspectives inégalitaires, mais cette fois sous une forme de "darwinisme social". L'ancienne capitale de l'AOF devint un lieu où le pouvoir s'affirmait et s'exerçait de manière subtile, et parfois crue. Les "fous", les "lépreux", les colporteurs et les hordes de villageois fuyant la misère des campagnes furent stigmatisés. Senghor lui-même fut le premier à évoquer l'"encombrement humain" à Dakar lors d'un congrès de son parti. Un arrêté de 1972 porta création d'un Comité national de lutte contre l'envahissement de Dakar par les colporteurs, lépreux et aliénés. Le terme "encombrement humain" fut par la suite officialisé lors d'un Conseil National de l'Union Progressiste Sénégalaise (UPS), le parti de Senghor. Cette terminologie seule révèle la manière dont la puissance publique gérait l'espace urbain. Elle donna lieu à une politique répressive des comportements sociaux tels que le vagabondage, la mendicité et les petits métiers de rue, qui furent transformés en "délits", justifiant des mesures coercitives à l'égard notamment des lépreux et des malades mentaux. Dans les discours officiels, les "bidonvilles", comme Fass Paillottes, étaient désignés comme une "pathologie urbaine". Cette ville proche de Dakar fut l'objet de multiples incendies, dont certains furent jugés suspects. La politique d'"haussmannisation" de Dakar n'épargna finalement pas Fass, qui fut transformé en HLM.
Ces dernières années, Dakar a évolué pour devenir une ville monstrueuse, sans âme, où le béton et la pollution continuent de disputer le droit de cité dans un espace urbain aride et insalubre, livré à la vision des "marchands de sommeil" et des trafiquants de tout genre.
Pour une réappropriation mémorielle de l'espace urbain
Face à ces visions d'horreur urbaine, il incombe aux ministères de l'Urbanisme et de la Culture du Sénégal de concevoir des politiques d'aménagement de l'espace public porteuses de sens. Une stratégie d'inscription spatiale et paysagère de la mémoire est essentielle pour la construction de l'identité nationale. Cela implique une mise en cohérence de l'espace urbain et une protection rigoureuse des lieux de mémoire, afin que les habitants puissent se réapproprier leur ville, raconter son histoire et la transmettre aux générations futures.
Il serait peut-être opportun que la mairie de Dakar envisage la production d'un "dictionnaire des lieux de mémoire" de la ville, avant que le vacarme incessant des pelleteuses n'impose le triste silence des ruines et que l'oubli ne consume définitivement les blessures de Dakar.
Par Dr. Adama Aly PAM



























