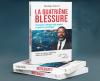Ce que dit la législation en vigueur

Le don de plus de deux milliards de francs CFA de l'homme d'affaires Mbackiyou Faye au khalife général des mourides a soulevé moult commentaires. Au-delà de la polémique, ‘’EnQuête’’ interroge la loi et les spécialistes pour voir s'il est interdit de garder de telles sommes à la maison ou de les utiliser dans le commerce juridique.
Mbackiyou Faye à Touba, remettant plus de deux milliards de francs CFA au khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké, en guise d'’’adiya’’. Avant lui, d'autres célébrités ont été poursuivies par la clameur pour circulation de sommes d'argent importantes en liquide. Mais est-il interdit par la loi en vigueur de détenir certaines sommes d'argent en liquide ? Qu'en est-il de la réglementation en vigueur sur les transactions au-delà de certains montants ? ‘’EnQuête’’ a essayé d'y voir plus clair, pour éclairer la lanterne.
Responsable juridique dans une grande banque de la place, ce spécialiste confie ne pas être en connaissance de texte interdisant de façon claire la détention de certaines sommes d'argent en liquide. “A ma connaissance, rien n'interdit à une personne de détenir deux milliards ou plus chez lui. Maintenant, la législation encadre de manière stricte la provenance et la mise en circulation de cet argent”, explique le spécialiste.
De ce point de vue, signale-t-il, il y a le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux. “D'abord, il y a ce qu'on appelle les déclarations de soupçon. Quand un client d'un certain profil vient faire des dépôts sans commune mesure avec ses revenus normaux, la banque est obligée de faire une déclaration d'opération suspecte, selon les lois anti-blanchiment”, analyse l'expert.
Selon cette réglementation, les organismes assujettis, dont les établissements de crédit, ont l'obligation de communiquer à la Centif “toute transaction en espèces (versement ou retrait) d'un montant supérieur à 15 millions de francs CFA”.
Outre ces dispositions, ajoute-t-il, il y a une instruction de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui prévoit que les paiements, “au-delà de cinq millions F CFA, ne peuvent pas se faire en espèces”. Ces paiements, selon lui, doivent passer obligatoirement par un compte. “C'est un autre moyen de lutter contre la circulation de certaines sommes hors des circuits bancaires”, a-t-il souligné.
Les dispositions de la BCEAO sur les transactions en espèces
Nous avons pu parcourir, sur le site de la Banque centrale, l'instruction n°233/07/2024 fixant le seuil pour le paiement d'une dette en espèces ou par instruments négociables au porteur. Aux termes de l'article 1er de cette instruction : “Est fixé à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, sans préjudice des dispositions spécifiques plus contraignantes en vigueur dans les États membres de l'UMOA, le seuil à partir duquel le paiement d'une dette ne peut être effectué en espèces ou par instruments négociables au porteur, qu'il s'agisse d'une opération unique ou de plusieurs opérations qui apparaissent liées.”
Toutefois, aux termes de l'article 2 portant sur les exemptions, “le seuil fixé à l'article premier de la présente instruction ne s'applique pas aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels”. Selon la loi, le non-respect des dispositions de l'instruction est passible des sanctions prévues par la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans les États membres de l'UMOA.
L'UEMOA et la loi sénégalaise sur les opérations impliquant des entités publiques
Au-delà de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a pris un certain nombre de dispositifs pour promouvoir la bancarisation et les moyens de paiement scripturaux. C'est dans ce cadre que s'inscrit la n°8/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 repris dans le droit interne sénégalais par la loi n°2004-15 du 4 juin 2004 relative aux mesures de promotion de la bancarisation et de l’utilisation des moyens de paiement scripturaux. Une loi qui vise particulièrement les opérations impliquant une entité publique.
En effet, aux termes de l'article 3 de ladite loi, “toutes opérations financières portant sur des sommes d’argent d’un montant supérieur ou égal au montant de référence fixé par instruction de la BCEAO entre, d’une part, les particuliers, entreprises et autres personnes privées et, d’autre part, les personnes publiques et parapubliques, notamment l’État, les administrations et les entreprises publiques, sont effectuées par chèque ou par virement sur un compte ouvert auprès des services financiers de La Poste ou d’une banque”. L'alinéa 2 de cette disposition de préciser que “les opérations financières portant sur des sommes d’argent inférieures au montant de référence peuvent être effectuées par tout autre moyen scriptural de paiement approprié ou en espèces”.
Dans le même sillage, l'article 4 de la loi de 2004 prévoit que “les salaires, indemnités et autres prestations en argent dus par l’État, les administrations publiques, entreprises ou autres personnes publiques et parapubliques aux fonctionnaires, agents, autres personnels en activité ou non ou à leurs familles ainsi qu’aux prestataires et portant sur des sommes d’argent d’un montant supérieur ou égal au montant de référence fixé par instruction de la BCEAO sont payés par chèque ou par virement sur un compte ouvert auprès des services financiers de La Poste ou d’une banque”.
L'encadrement de la thésaurisation de l'argent
Interpellé sur la problématique de la circulation des espèces dans le commerce juridique, ce professeur en droit bancaire soutient que “l’argent est un moyen de paiement ; on ne peut donc interdire sa circulation”. On peut, toutefois, selon ses explications, “réglementer cette circulation de zone monétaire à zone monétaire ou demander des justifications pour les paiements au-delà d’un certain montant, à cause de la lutte contre la corruption et le blanchiment de l'argent sale”.
Mais d'où sort donc cette assertion selon laquelle la thésaurisation, qui consiste à garder des sommes importantes hors des établissements homologués, est interdite ? Le professeur de droit explique : “C'est vrai qu’il peut être suspect de garder certains montants à la maison ou dans les coffres sans autorisation. Mais si on trouve ces montants et qu’il y a une justification, il ne peut y avoir aucun problème, sous réserve des textes de la BCEAO qui exigent que ‘les paiements se fassent par chèque ou par banque, au-delà d’un certain montant’. Mais je crois que personne ne suit, à part les entreprises.”
Le développement du paiement électronique : une solution
De l'avis de l'universitaire, le problème est plus sociétal. L’argent liquide, selon lui, a de beaux jours à cause du manque de confiance dans le système bancaire ou de sa complexité pour certains opérateurs. L'espoir est toutefois permis avec le développement des moyens de paiement électronique. “Avec ces modes de paiement qui se développent, l’argent liquide devrait entamer sa disparition. Je crois qu’avec les enfants des années 2000, le liquide va disparaître. Il ne sert donc à rien de se presser. Par contre, la vieille génération préfère le bon vieux liquide”, raille le professeur de droit bancaire.
En définitive, il faut retenir que dans notre réglementation, aucun texte, à la connaissance des experts interpellés, n'interdit la thésaurisation de l'argent. La législation encadre cependant l'utilisation de cet argent dans le commerce juridique, à travers notamment les lois anti-blanchiment, les instructions de la BCEAO et les lois nationales.
En outre, nous n'avons trouvé aucun texte limitant les opérations de personne à personne, en dehors des circuits professionnels. Les instructions de la BCEAO citées en référence prévoient des exemptions sur ces types de transactions.
Cela dit, l'État, qui peut ouvrir une enquête en cas de soupçon de circulation d'argent sale, peut bien vérifier la provenance licite ou illicite de ces mannes financières.