Les lois mémorielles sur l'esclavage et la colonisation font-elles plus de mal que de bien ?
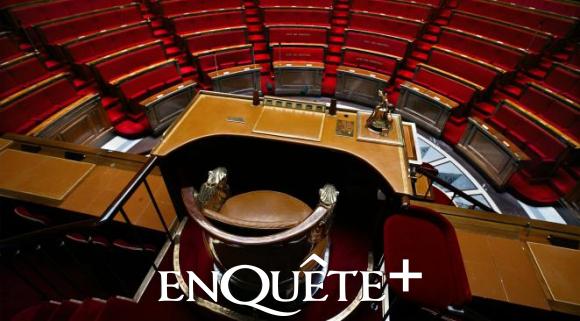
La 8e édition de la Semaine anti-coloniale se déroule cette année en France du 16 février au 3 mars 2013. L’initiative, lancée par l’association « Sortir du Colonialisme » en partenariat avec Saphirnews et Salamnews, réunit tous les ans, à la même période, des dizaines d’organisations et d’associations qui luttent contre le racisme et le colonialisme.
Atlantico : Du 16 février au 3 mars 2013 se déroule la Semaine anti-coloniale où sont consacrées les luttes anti-coloniales, d’hier et d’aujourd’hui. Rosita Destival, une Française d'origine guadeloupéenne, descendante d'esclaves, a assigné l'Etat pour crime contre l'humanité. Elle est soutenue par le Conseil représentatif des associations noires (Cran) qui estime que le gouvernement n'a pas tenu les promesses faites en matière de réparations. Dans ces cas-là, comment faire la part des choses entre ce qui relève de la juste reconnaissance du passé et de la repentance ?
Dimitri Casali : Ces associations communautaires et groupes de pression sèment une fois de plus un sentiment de haine et de suspicion entre tous les Français, creusant encore plus le fossé qui les sépare. Nous sommes le seul peuple au monde (à l’exception des Allemands pour les raisons que nous connaissons tous) à cultiver la repentance à un tel niveau. Si on écoutait ces associations, on condamnerait bientôt Périclès ou Jules César pour crime contre l’Humanité pour avoir pratiqué, institutionnalisé et défendu l’esclavage dans leurs cités. On oublie sans cesse de replacer l’Histoire dans le contexte général et de rappeler, simplement, que depuis la plus haute Antiquité, l’esclavage était pratiqué par toutes les sociétés et ne scandalisait pas. Cela paraît fou, mais c’était alors la loi du vainqueur. Bien sûr, il faut dire et redire combien la traite négrière fut un commerce abominable et injustifiable, et que cette époque est à jamais révolue. Il faut condamner, mais préciser aussi que l’esclavage n’a pas été le fait des seules nations occidentales, mais bien du monde entier. Il faut condamner, mais sans occulter un fait fondamental : les première nations au monde à avoir aboli et interdit l’esclavage sont l’Angleterre (1833), le Danemark (1847) puis la France (1848). Donc au lieu de distiller ces idées de haine, il faudrait plutôt célébrer le fait positif que les nations européennes ont été les premières au monde à y mettre fin. Ou alors, exigeons que le monde entier fasse son mea culpa (aussi bien les pays européens qu’arabes, africains et asiatiques). Ces associations feraient mieux de s’occuper de ce qui se passe aujourd’hui puisque l’esclavage persiste encore de nos jours. La Mauritanie n’a adopté une loi qui réprime la détention d’esclave qu’en 2007, le Mali et le Niger pratiquaient l’esclavage jusque dans les années 1980. En ce moment même, le combat contre l’esclavage perd du terrain au Soudan, au Congo, mais aussi au Yémen ou à Oman. Le nombre de pays ne respectant pas les standards internationaux pour lutter contre ce fléau a doublé, atteignant un total de vingt-trois selon rapport annuel du Département d’État américain. Le travail forcé, la traite sexuelle, l’exploitation des travailleurs émigrés concerneraient 27 millions d’individus en 2012.
Pourtant, rien ne justifie, et surtout pas le droit international, que les Français aient, cent soixante huit ans après, à endosser collectivement la marque des malheurs et des sévices de l’Histoire. « Le mal n’est pas une maladie collectivement transmissible et le passé n’est pas une fatalité », a écrit justement l’historien Jean-Pierre Rioux. Mais depuis une dizaine années les lois mémorielles et en particulier la loi Taubira (2001) ont incité ces groupes communautaires à se définir comme des victimes de crime contre l’Humanité dont ils aiment se présenter comme des descendants directs. On voit là l’usage anachronique et dangereux de notions récentes, qui ont servi à juger les responsables nazis devant le tribunal international de Nuremberg.
Les lois mémorielles, comme la loi Taubira, et la logique dans laquelle elle s'inscrit, a-t-elle ouvert la boîte de Pandore ?
Dimitri Casali : Oui assurément, l’ancien Garde des Sceaux Robert Badinter rappelait à juste titre dans mon livre l’Histoire de France Interdite (Lattès 2012) : « Les lois mémorielles, que j'appelle des lois compassionnelles, n'ont absolument pas leur place dans l'arsenal législatif. Une vérité historique n’a pas besoin d’être protégée, puisqu’il existe les décisions de justice ». Et pourtant, la loi Taubira (2001) qui définit l’esclavage pratiqué du XVe au XIXe siècle – et seulement celui ci– comme crime contre l’Humanité, exige que, non seulement la mémoire des esclaves, mais aussi « l’honneur de leurs descendants soient défendus », ce qui légitime et légalise pour la première fois dans l’Histoire l’étrange principe du malheur héréditaire.
Bref, c’est ce qu’on appelle la concurrence victimaire, comme si pour évoquer la souffrance des uns, il fallait oublier celle des autres ; comme si nous étions entrés dans une époque où nous serions tous des victimes ou les descendants des victimes d’hier ; comme si le monde occidental tout entier, et la France en particulier, devaient faire chaque jour acte de contrition.
L’historien Olivier Pétré Grenouilleau a rappelé à juste titre : la qualification de « génocide » ne peut s’appliquer à la traite négrière puisqu’elle n'a pas pour but d'exterminer tout un peuple. Pour lui, la loi Taubira est aussi une relecture partielle de l'histoire parce qu’elle omet de citer la traite arabe et la traite intra-africaine, plus importantes que la traite Atlantique. Je cite « L’Afrique Noire n’a pas été seulement une victime de la traite, elle en a été l’un des principaux acteurs »...
N'ont-elles pas fait plus de bien que de mal ? En quoi ? (On pense notamment à l'instrumentalisation qui peut en être faite par les négationnistes...)
Dimitri Casali : Le plus grave dans la loi Taubira ce sont ses conséquences puisque elle prescrit, par injonction législative, son enseignement systématique dans tous les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines. Encouragé le travail de lobbying des minorités communautaristes et des chercheurs au CNRS elles ont réussi à dicter leur propre vision de l’histoire de France au Conseil supérieur de l’Éducation nationale. Hubert Tison de l’APHG (Association des professeurs d’histoire géographie) reconnaissait leur puissance dans la revue Historia : « Il a existé des interventions de groupes mémoriels sur la traite et l’esclavage. » Résultat ce sentiment de culpabilité est devenu symptomatique de l’esprit français contemporain. Si cela continue, il va falloir que, tous les matins en se levant, les Français se donnent dix coups de fouet pour se faire pardonner d'avoir été d’horribles esclavagistes au XVIIIe siècle, des colonialistes monstrueux au XIXe et des collabos au XXe ! Une situation de repentir à sens unique : jamais exigé des autres cultures, des autres régimes, des autres peuples. Pourtant, toutes les civilisations ont été expansionnistes : les Arabes, les Chinois, les Perses, les Mongols, les Incas, les Aztèques. Toutes ont semé le feu, le fer et la désolation, détruisant des religions locales, massacrant des populations entières. Citons ici Pierre Nora : « l’Histoire n’est qu’une longue suite de crimes contre l’humanité (…) Deux mille ans de culpabilité chrétienne relayée par les droits de l'homme se sont réinvestis, au nom de la défense des individus, dans la mise en accusation et la disqualification radicale de la France. Et l'école publique s'est engouffrée dans la brèche avec d'autant plus d'ardeur qu'à la faveur du multiculturalisme, elle a trouvé dans cette repentance et ce masochisme national une nouvelle mission. (Liberté pour l’Histoire, éditions du CNRS 2008).
De manière générale, l’État doit-il interférer dans le travail des historiens ?
Dimitri Casali : Nos élus peuvent et doivent voter des textes sur l’instauration d’une journée de commémoration ou sur l’édification d’un mémorial, mais ils ne doivent surtout pas proclamer de vérités historiques intangibles. La complexité de l’Histoire, véritable procédure de vérité, est bien trop soumise aux aléas des pressions communautaires. Sans quoi nous verrions bientôt se multiplier des demandes de reconnaissance de crime contre l’Humanité : pourquoi ne pas admettre les requêtes des Vendéens, des protestants et autres Albigeois massacrés au XIIIe siècle… Le Parlement, aujourd’hui, a trop tendance à remplacer le juge, alors que seul ce dernier dispose du pouvoir de prononcer des condamnations, l'autorité judiciaire possédant, selon l'article 64 de la Constitution, une indépendance garantie par le Président de la République. En conséquence, la Constitution ne permet pas au législateur de « condamner » des faits du passé, en les qualifiant par le recours aux concepts juridiques de crime contre l'Humanité ou de génocide. Et pourtant, personne à ce jour n’a osé abroger la loi Taubira.
Les enjeux du présent expliquent ces relectures du passé. Nos dirigeants sont-ils à ce point désemparés pour laisser passer les excès de ces associations communautaires ? Il faut dire et redire haut et fort que la France n’a commis aucun génocide, n’a jamais engendré de totalitarisme, n’a pas inventé la « solution finale », ni déclenché le feu nucléaire. En 1958 Albert Camus avait déjà écrit : « Il est bon qu’une nation soit assez forte de tradition et d’honneur pour trouver le courage de dénoncer ses propres erreurs. Mais elle ne doit pas oublier les raisons qu’elle peut avoir de s’estimer elle-même. Il est dangereux, en tout cas, de lui demander de s’avouer seule coupable et de la vouer à une pénitence perpétuelle. »
Atlantico

























